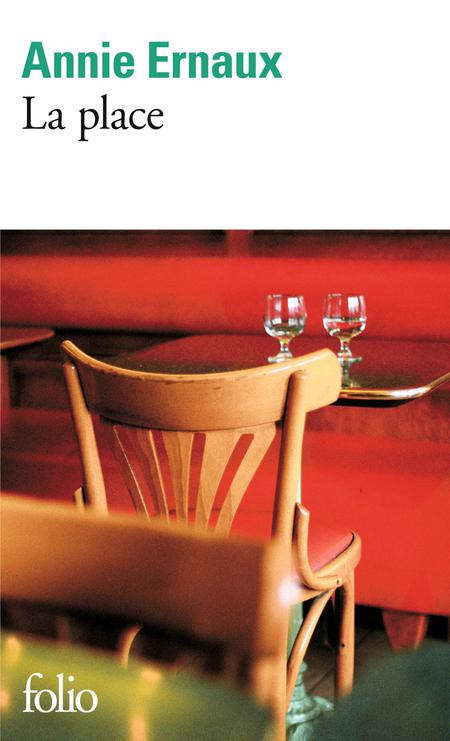31st October 2022
5 Questions à…
Armelle Vautrot
Elle a bâti son parcours professionnel en suivant son fil personnel : l’engagement envers les plus vulnérables. Rencontre et partage avec Armelle Vautrot, professionnelle du soin pluridisciplinaire qui nous parle, entre autres, de réhabilitation psychosociale.
1) Vous dites adorer votre travail : quel est-il ?
C’est aider et accompagner ceux qui en ont besoin (en particulier les plus vulnérables), dans l’éducation comme dans la santé, c’est développer des compétences et de l’autonomie chez ceux qui éprouvent des besoins particuliers, à tout âge, c’est aussi les accompagner dans la responsabilisation (dont l’empowerment) et l’épanouissement personnel. Pour cela, j’utilise dans la médiation relationnelle les pratiques artistiques : écriture, musique, contes, danse et théâtre comme porte d’entrée vers l’expression et la connaissance de soi. Aussi bien dans l’enseignement qu’en thérapie.
Mon travail est de fédérer le collectif à partir du singulier en favorisant la collaboration et le partage des savoirs (expérientiel, théorique et scientifique, clinique). Je m’informe, je me forme encore et toujours, en recherche permanente de nouveaux acquis, en ébullition, et en conservant une part d’autocritique sur ma pratique et sur mes connaissances pour ne jamais rester prisonnière de certitudes. Quand on me dit que j’étais « autrefois » musicienne ou professeure, je réponds que je le suis toujours, car je n’ai pas cessé de pratiquer un métier pour un autre, je tisse une activité professionnelle pluridisciplinaire forte de toutes les autres en restant toujours au service de l’humain.
Mon travail actuel réunit tout ce que j’ai pu faire. Il me permet de pratiquer tout ce que j’aime et de me mettre au service des autres : l’engagement est le fil rouge de ma vie.
2- Citez-moi cinq raisons pour lesquelles vous pratiquez votre activité…
Raison 1 : l’engagement au service des autres et surtout des plus vulnérables. Je travaille sur le handicap, sur les violences faites aux femmes, je suis active dans des associations comme Planète Autisme et Un maillon manquant. Et puis mon activité me permet d’être en accord avec mes convictions et mon éthique.
Raison 2 : la richesse et le renouvellement des pratiques. Il existe énormément de possibilités en matière de thérapie et des recherches ont lieu dans le monde entier, où de nouvelles approches se développent. Les sciences humaines commencent à entrer dans les pratiques médicales, notamment par le biais de l’éthique du soin (care).
Raison 3 : l’émulation intellectuelle et cognitive. J’apprends de l’université, donc de la recherche, mais j’apprends énormément aussi des patients, de leurs expériences, de leurs ressentis, de leur évolution. J’éprouve une profonde gratitude pour chaque personne qui s’assoit en face de moi, car c’est un partage et une transmission bilatérale.
Raison 4 : la diversité. J’exerce plusieurs activités différentes et ma semaine s’organise de manière qu’il y ait les jours de consultation, les jours d’écriture, les jours de formation (que je donne ou que je reçois) et les pratiques artistiques (danse, écriture, musique).
Raison 5 : la liberté. C’est un luxe que je chéris : j’ai travaillé longtemps pour d’importantes institutions (Education nationale, enseignement supérieur et secteur de la recherche), et le poids administratif et les contraintes logistiques y nuisent souvent à la créativité et freinent l’innovation. Comme j’ai toujours été une boulimique de travail et une passionnée, je peux maintenant gérer cela librement.
3) Vous m’avez parlé de thérapie « intégrative » et de « psychologie humaniste »…
En effet. Certains exercent la thérapie selon un dogme. Ils ne pratiquent par exemple que la psychanalyse, que les thérapies comportementales et cognifives (TCC), ou ne jurent que par les médicaments dans le soin psychique. Mais la temporalité de chaque patient.e lui appartient. Il est important de sortir des dogmes et d’accueillir les besoins de chacun.e pour y répondre le mieux possible. C’est là que la pratique clinique devient intégrative : quand elle adapte le cadre, l’ouvre, le malaxe, le pétrit, le casse pour le recréer.
J’y suis particulièrement sensible, car ma formation est pluridisciplinaire : diplômes obtenus en faculté de lettres, en sciences humaines, en sciences de la santé, en faculté de médecine. J’y ai ajouté des certifications spécifiques, enrichies de formations professionnelles variées : EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), art-thérapie, mindfulness, psychologie positive, hypnose éricksonienne et TCC (troubles anxieux, trauma). De fait, je peux faire du sur-mesure en convoquant des outils très différents. Je cherche toujours comment faire avancer et progresser chaque personne, en respectant son rythme et ses contraintes.
La psychologie humaniste est héritée de Carl Rogers. Cela induit de s’appuyer sur le potentiel de chacun, de chercher avec lui les ressources dont il dispose, de les activer et de les développer pour plus d’autonomie. C’est finalement le fondement de l’empowerment en santé mentale. Cela participe pour moi de la réhabilitation psychosociale : chaque patient.e a sa place dans la société, quelle que soit sa problématique (transitoire ou pérenne). Il faut juste l’accompagner pour que la personne trouve cette place et qu’elle lui offre le bien-être et l’épanouissement auxquels chaque personne a droit. La psychologie humaniste est un levier puissant dans mes deux spécialités : le trauma et l’autisme.
4) Quel a été votre parcours professionnel et personnel ?
J’ai été une élève « à profil particulier » comme on dit. J’ai été diagnostiquée HP (on disait alors « enfant précoce ») en maternelle : résultats scolaires très performants, mais vulnérabilités émotionnelles patentes. J’ai appris la musique en apprenant à lire, encouragée par mes parents, qui me permettaient de me « nourrir » intellectuellement.
J’ai eu mon bac en avance. En même temps, je passais un concours en flûte traversière et en musique de chambre en conservatoire, je jouais dans un orchestre et je décrochais mon diplôme d’éducation musicale. Puis je suis entrée à l’université, tout en poursuivant la musique et en l’enseignant. J’ai ajouté à ma formation le chant lyrique et le chant choral, appris en conservatoire jusqu’à plus de 30 ans. Après des études de lettres à la Sorbonne, je me suis spécialisée en sciences du langage. J’ai travaillé sur des auteurs vivants (Philippe Djian, Daniel Pennac, Yves Simon) et sur l’implicite dans le discours. J’ai réussi deux concours de l’enseignement : le concours de recrutement de professeurs des écoles et le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré. J’ai enseigné en école primaire, collège et lycée. A 27 ans, j’ai été recrutée à l’université pour y enseigner en licence, master, et en formation des enseignants. Sur un plan personnel, j’ai eu deux enfants, que j’ai très vite dû élever seule. Si ça a un peu compliqué les choses, ça m’a fait développer un solide sens de l’organisation et une grande efficacité dans mon travail. J’ai publié dès 2002 en édition scolaire et parascolaire, puis j’ai été nommée directrice de collection chez Bordas. C’est beaucoup de travail, effectué pour ma part quand les enfants étaient couchés, quand j’étais en vacances ou le week-end. Lors de mon entrée dans la quarantaine, j’ai ressenti un besoin de renouveau. J’ai écrit là-dessus, d’ailleurs (Enfin 40 ans !, Les supers pouvoirs de la femme quadra).
Aujourd’hui, je poursuis l’écriture avec un ouvrage par an, en psychologie. Le prochain sort à la fin de ce mois d’octobre. J’ai la chance de trouver chaque fois des éditeurs qui me suivent dans mes projets. Là aussi je ressens une immense gratitude pour ces aventures partagées.
J’ai quitté la région parisienne pour la Drôme, puis j’ai atterri en Ardèche. J’y ai démarré de nouvelles études tout en travaillant. Puis, après les attentats de 2015, j’ai commencé une recherche universitaire sur l’expression du traumatisme. Ce travail m’a fait rencontrer des rescapé.e.s du Bataclan, dont Fred Dewilde, avec qui j’ai écrit Dessine-moi un trauma – Trouver la voie de la résilience après le Bataclan.
Depuis, je ne quitte plus l’université ! J’entreprends chaque année un diplôme universitaire (DU) différent et hors des sciences humaines, en faculté de médecine et en sciences de la santé. Je m’investis beaucoup également dans Planète Autisme et je crée des approches innovantes en habiletés psychosociales grâce à la médiation artistique relationnelle. Avec tout type de public : des enfants, des adolescent.e.s, de jeunes adultes, autistes avec ou sans déficience.
5) Quels sont vos projets dans les cinq mois à venir ?
J’ai créé mon organisme de formation et édition avant l’été : Phare (Psychologie, humanisme, aidance, recherche, éducation). Il a obtenu la certification Qualiopi, qui garantit la qualité des prestations et permet aux participants de prétendre à un financement. Je développe des formations courtes, pragmatiques et pluridisciplinaires. Un.e professionnel.le du soin travaille en binôme avec un.e professionnel.le d’une discipline convoquée dans la médiation artistique relationnelle. Je développe aussi un format « Un jour + Une heure » sur des thématiques féminines et féministes : l’empowerment des femmes neuroatypiques, la reconversion au féminin par exemple.
Les formations reposent sur l’hybridation du public pour permettre la convergence des savoirs (expérientiel, théorique et scientifique, clinique) : y participent des professionnels (santé, éducation, social, arts), des aidants, des personnes concernées par la question. Dans les cinq mois qui viennent, je propose des formations sur l’approche psychocorporelle, en décembre dans la Drôme, également la pratique du dessin et de l’écriture, début 2023 dans la même région. Entre autres.
Je suis très fière du site Phare, qui a été créé par une équipe 100 % féminine et créative. C’est une très belle collaboration qui se prolonge, puisque j’ai demandé à Anne Laffont, la graphiste, de devenir l’illustratrice des « P’tits Cahiers du Phare ».
Le premier (Mes Emotions et moi) est sorti fin juillet, le deuxième (Mon Corps et moi) est édité à la Toussaint, le troisième (L’Autisme et moi) paraîtra en janvier 2023. J’en achève d’ailleurs en ce moment l’écriture.
Dans ces cahiers, je suis thérapeute, autrice, compositrice et interprète. J’ai créé un support numérique en réalité augmentée pour chaque cahier, afin d’ajouter des documents sonores. La collection « Les P’tits Cahiers », un outil interactif, pour les enfants et les adolescents mais aussi pour tout adulte qui accompagne des jeunes (professionnels, parents, grands-parents). Du côté de l’écriture personnelle, je travaille actuellement sur deux ouvrages : un sur l’autisme au féminin, et l’autre sur le trauma à partir de la recherche que je mène depuis 2018. Début 2023, je vais poursuivre ma formation HandiDanse auprès de l’académie Avio et de la Fédération HandiDanse adaptée inclusive pour développer cette pratique professionnelle, qui a commencé cette année avec les ateliers Dans ma bulle*. Pour finir, j’espère que ces prochains mois me réserveront de belles rencontres et plein d’imprévus : c’est ce qui me permet de me sentir en vie et de poursuivre mon engagement dans le collectif.
Propos recueillis par Claudine Cordani
(lien) www.phareformationedition.fr
(lien) * Les ateliers « Dans ma bulle » ont été créés en septembre 2022 pour l’école de danse Quentin Gremillet avec la danseuse Françoise Koll.